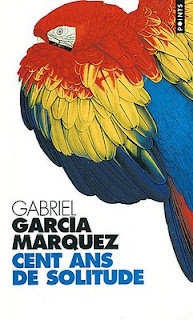Jonathan Safran Foer est l'auteur de l'un des livres m'ayant le plus bouleversée en 2007, Extrêmement fort et incroyablement près, Éditions de l'Olivier.
Ce deuxième roman trouvait sa source dans les attentats du 11 septembre 2001 qui ont transformé l'Amérique et le monde à jamais.
Dans sa première publication, écrite à l'âge de 25 ans et intitulée Tout est illuminé (il a le sens du titre), l'auteur puise dans ses origines juives et dans l'histoire de sa famille pour nous offrir un texte habilement construit et extrêmement fort.
Le personnage principal de Tout est illuminé, Jonathan Safran Foer lui-même, part à la recherche de la femme qui a jadis sauvé son grand-père des nazis, en Ukraine, dans un Shetl nommé Trachimbrod. À partir d'une photographie, et aidé par Alex, un jeune homme traducteur qui rêve à l'Amérique, le héros (ainsi Alex le nomme-t-il) va parcourir le pays dans une quête initiatique de ses origines.
La narration démarre avec le récit de la vie dans le Shetl de Trachimbrod en 1791, dans un style frôlant le réalisme magique de Gabriel Garcia Marquez (un bébé "apparaît" dans la rivière, un homme vit avec une scie dans la tête, etc.) et ce n'est peut-être pas pour rien que j'ai lu - complètement par hasard - Cent ans de solitude tout de suite après Tout est illuminé. L'histoire du shetl se poursuit jusqu'en 1942, alors que la Deuxième Guerre Mondiale fait rage et que les Juifs d'Ukraine sont exterminés par les Nazis.
Les chapitres sont ensuite découpés entre cette narration historique et les lettres qu'Alex envoie à Jonathan après le retour de celui-ci chez lui aux États-Unis, et le récit des recherches de Jonathan à proprement parler. Il s'agit de la rencontre de l'ouest et de l'est, des rêves d'Alex aux déceptions de Jonathan, l'un étant un peu le pendant de l'autre.
En fait, Alex est là pour traduire et aider Jonathan à écrire son livre, ce qui donne naissance à une langue savoureuse et très imagée, puisqu'Alex est on ne peut plus approximatif avec la langue anglaise (le texte original est en anglais bien sûr). De là, un coup de chapeau aux traducteurs du livre en français, Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso, qui ont su reproduire des expressions sorties de nulle part...
Un conseil : si vous débutez ce livre, et que vous vous sentez déconcertés par le début, forcez un peu la lecture, afin de découvrir un texte étonnant, alliant «le burlesque à la tragédie» en faisant un détour dans le monde du réalisateur Émir Kusturica.
Voici une belle introduction pour vous encourager à découvrir ce jeune auteur :
«Jonathan Safran Foer fait partie de ces écrivains inventifs qui conçoivent la littérature comme "un désordre des dents". Maniant le verbe avec une rare dextérité, il fait subir au langage toutes les distorsions possibles sans que cela jamais ne vire à l'exercice de style ou à l'incompréhension fumeuse. Parce que ce jeune auteur américain a trouvé en littérature le meilleur prétexte qui soit pour nous entraîner à la suite de ses phrases à l'humour foudroyant : une histoire à raconter. Une histoire pleine d'accidents banals et d'incroyables résurrections, de bébés sauvés des eaux, d'étudiants égocentriques, de vieillard malheureux, de rabbins pernicieux. De moments graves aussi. Une histoire donc.
Alex, un jeune Ukrainien, vivant aux crochets de sa famille, collectionnant selon ses dires, filles et succès, est entraîné par son père dans un voyage improbable à travers le pays : guider un écrivain juif américain, Jonathan Safran Foer lui-même à la recherche de ses origines et d'un village détruit en 1941 par les nazis. Si vous ne dépassez pas le premier chapitre (impossible), vous vous direz que l'auteur a bien du talent et de l'humour, pour faire s'exprimer de la sorte son personnage. En entamant le second chapitre, vous penserez que Jonathan Safran Foer est un écrivain profond, véritable, qui aurait bien du mal à dissimuler ses qualités. Et que dans le difficile exercice d'un premier roman cultivant tous les styles, inventif ou solennel, riche ou effilé jusqu'à l'essentiel, ce nouvel auteur américain frise le génie. »
--Hector Chavez
Un blogue qui parle du livre
Et un autre...
En écrivant ceci, j'écoute Stuart A. Staples, Leaving Songs (Beggars Banquet, 2006), avec une superbe chanson (That Leaving Feeling) à laquelle participe la Montréalaise Lhasa De Sela...
Ce deuxième roman trouvait sa source dans les attentats du 11 septembre 2001 qui ont transformé l'Amérique et le monde à jamais.
Dans sa première publication, écrite à l'âge de 25 ans et intitulée Tout est illuminé (il a le sens du titre), l'auteur puise dans ses origines juives et dans l'histoire de sa famille pour nous offrir un texte habilement construit et extrêmement fort.

Le personnage principal de Tout est illuminé, Jonathan Safran Foer lui-même, part à la recherche de la femme qui a jadis sauvé son grand-père des nazis, en Ukraine, dans un Shetl nommé Trachimbrod. À partir d'une photographie, et aidé par Alex, un jeune homme traducteur qui rêve à l'Amérique, le héros (ainsi Alex le nomme-t-il) va parcourir le pays dans une quête initiatique de ses origines.
La narration démarre avec le récit de la vie dans le Shetl de Trachimbrod en 1791, dans un style frôlant le réalisme magique de Gabriel Garcia Marquez (un bébé "apparaît" dans la rivière, un homme vit avec une scie dans la tête, etc.) et ce n'est peut-être pas pour rien que j'ai lu - complètement par hasard - Cent ans de solitude tout de suite après Tout est illuminé. L'histoire du shetl se poursuit jusqu'en 1942, alors que la Deuxième Guerre Mondiale fait rage et que les Juifs d'Ukraine sont exterminés par les Nazis.
Les chapitres sont ensuite découpés entre cette narration historique et les lettres qu'Alex envoie à Jonathan après le retour de celui-ci chez lui aux États-Unis, et le récit des recherches de Jonathan à proprement parler. Il s'agit de la rencontre de l'ouest et de l'est, des rêves d'Alex aux déceptions de Jonathan, l'un étant un peu le pendant de l'autre.
En fait, Alex est là pour traduire et aider Jonathan à écrire son livre, ce qui donne naissance à une langue savoureuse et très imagée, puisqu'Alex est on ne peut plus approximatif avec la langue anglaise (le texte original est en anglais bien sûr). De là, un coup de chapeau aux traducteurs du livre en français, Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso, qui ont su reproduire des expressions sorties de nulle part...
Un conseil : si vous débutez ce livre, et que vous vous sentez déconcertés par le début, forcez un peu la lecture, afin de découvrir un texte étonnant, alliant «le burlesque à la tragédie» en faisant un détour dans le monde du réalisateur Émir Kusturica.
Voici une belle introduction pour vous encourager à découvrir ce jeune auteur :
«Jonathan Safran Foer fait partie de ces écrivains inventifs qui conçoivent la littérature comme "un désordre des dents". Maniant le verbe avec une rare dextérité, il fait subir au langage toutes les distorsions possibles sans que cela jamais ne vire à l'exercice de style ou à l'incompréhension fumeuse. Parce que ce jeune auteur américain a trouvé en littérature le meilleur prétexte qui soit pour nous entraîner à la suite de ses phrases à l'humour foudroyant : une histoire à raconter. Une histoire pleine d'accidents banals et d'incroyables résurrections, de bébés sauvés des eaux, d'étudiants égocentriques, de vieillard malheureux, de rabbins pernicieux. De moments graves aussi. Une histoire donc.
Alex, un jeune Ukrainien, vivant aux crochets de sa famille, collectionnant selon ses dires, filles et succès, est entraîné par son père dans un voyage improbable à travers le pays : guider un écrivain juif américain, Jonathan Safran Foer lui-même à la recherche de ses origines et d'un village détruit en 1941 par les nazis. Si vous ne dépassez pas le premier chapitre (impossible), vous vous direz que l'auteur a bien du talent et de l'humour, pour faire s'exprimer de la sorte son personnage. En entamant le second chapitre, vous penserez que Jonathan Safran Foer est un écrivain profond, véritable, qui aurait bien du mal à dissimuler ses qualités. Et que dans le difficile exercice d'un premier roman cultivant tous les styles, inventif ou solennel, riche ou effilé jusqu'à l'essentiel, ce nouvel auteur américain frise le génie. »
--Hector Chavez
Un blogue qui parle du livre
Et un autre...
En écrivant ceci, j'écoute Stuart A. Staples, Leaving Songs (Beggars Banquet, 2006), avec une superbe chanson (That Leaving Feeling) à laquelle participe la Montréalaise Lhasa De Sela...