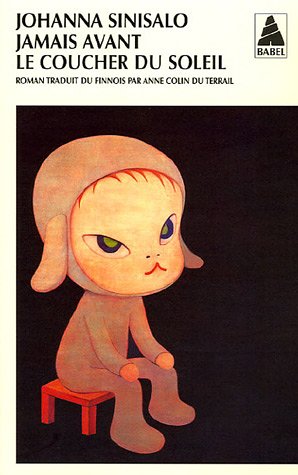Élégie pour un Américain, Siri Hustvedt, Éditions Actes Sud, 2008, 394 pages.
Élégie pour un Américain, Siri Hustvedt, Éditions Actes Sud, 2008, 394 pages.À la mort de leur père, Erik et Inga font leur devoir de mémoire en partant à la recherche d’une mystérieuse Lisa, évoquée dans les écrits de leur père.
En voulant comprendre la vie de leur père, ce sont leurs propres vies qui vont être bouleversées. Erik, brillant psychiatre, se remet de son divorce en tombant amoureux de sa nouvelle locataire, Miranda, une jamaïcaine mère célibataire aux prises avec un ex, artiste photographe un peu trop harcelant. Inga, auteur d'essais philosophiques, que la mort de son mari, un auteur célèbre, a traumatisée, tente de mettre à nu les émotions de sa fille Sonia, tout en affrontant les fantômes de son passé, et notamment une maîtresse de son mari…
Tout cela sur fond de 11 septembre, dans une Amérique qui se remet en question, et où les racines de chacun n’ont jamais eu autant d’importance (les esclaves marrons pour Miranda, les immigrants norvégiens pour Érik et Inga).
Ce livre est à ranger sur la même étagère que Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, L’histoire de l’amour de Nicole Krauss, ou même (et surtout) Lignes de faille de Nancy Huston.
Il évoque avec beaucoup de finesse notre monde contemporain, avec notre quête d’identité perpétuelle, la lourdeur et la folie de nos sociétés consuméristes. Les personnages sont poussés à l'introspection permanente.
Siri Hustvedt, grande connaisseuse artistique (elle a écrit Les Mystères du rectangle, essais sur la peinture, en 2006), se rapproche ici du monde de la psychanalyse, par son personnage principal. Autour de lui gravite plusieurs artistes : Miranda, qui peint, et Jeffrey Lane, son ex, qui par son propos et sa façon d’agir, n’est pas sans rappeler l’artiste disjoncté de Tout ce que j’aimais, son précédent roman.
D’ailleurs, Siri Hustvedt use d’un procédé que j’aime particulièrement : elle refait vivre certains de ses personnages de ses précédents livres dans de petites scènes. Ainsi, dans la scène du souper chez Inga, on retrouve un Léo vieillissant, qui ne s’est jamais remis de la mort de son fils Matthew dans Tout ce que j’aimais. Ces petits « caméos littéraires » assurent une continuité dans ses ouvrages et ses thématiques.
New York reste elle-même un personnage à part entière, et l’on retrouve tout l’amour que l’auteur porte à cette ville dans ses descriptions. Les quelques voyages des deux protagonistes principaux dans leur Minnesota natal reconnecte l’auteur avec ses origines norvégiennes et avec la thématique de l'immigration.
La trame narrative est jalonnée par les rencontres avec les clients d’Erik, âmes perdues et esseulées, qui le confrontent dans sa propre solitude.
La mélancolie qui se dégage à la lecture de ce livre nous ramène au titre, une élégie étant un poème lyrique de facture libre, écrit dans un style simple qui chante les plaintes et les douleurs de l'homme, les amours contrariés, la séparation, la mort.
Élégie pour un américain est un roman complexe, qui se lit par petites touches.
"Elégie pour un Américain" ne déçoit pas. C'est un très beau texte, ambitieux, fort, lourd aussi, à force de pousser les uns et les autres dans leurs retranchements, jusqu'au bout de leurs blessures et de leurs manques. (...) On pense effectivement à Don DeLillo ou à Richard Ford dans sa façon de psychanalyser l'identité, les névroses états-uniennes, d'une écriture sans affectation. Non sans exceller à rendre les émotions palpables, les sentiments tangibles. Siri Hustvedt est vraiment un grand écrivain.
Delphine Perras, L'Express 06/06/2008