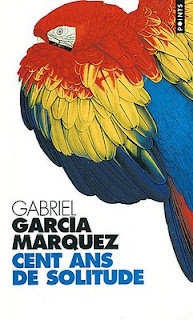Nick Cave and The Bad Seeds - Métropolis de Montréal, 2 octobre 2008
Nick Cave est de ces artistes au charisme hallucinant, avec biographie à rallonge, collaborations à n'en plus finir, évoluant dans son art avec fougue et honnêteté, du punk des premiers albums en 1984 à la chanson intime des albums plus récents comme
The Boatman's Call (1997) ou
No More Shall We Part (2001). Sa musique n'est pas commerciale, plutôt underground, mais il remplit des salles de 2000 personnes qui le vénèrent.
Certaines de ses chansons sont cultes, comme
The Mercy Seat, de l'album
Tender Prey, paru en 1988. Depuis cette date, Nick Cave a chanté cette chanson dans quasi chacun des concerts qu'il a donnés, c'est sa préférée. Nous y avons aussi eu droit - pour mon plus grand bonheur - hier soir.
Le personnage est fascinant, sorte de poète écorché, maudit et malheureux, aujourd'hui beaucoup plus serein semble-t-il. Rescapé de plusieurs overdoses, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, comme on dit si bien et de façon convenue...
Il a fait chaviré le coeur de nombreuses femmes (dont P.J Harvey), et la paternité l'a paraît-il assagi (et lui a inspiré un très beau disque,
The Good Son, en 1990). Ses enfants vivent dans le monde entier, 3 en Australie, sa patrie natale, 1 au Brésil, et ses jumeaux à Londres, son lieu de résidence actuel.
Il s'intéresse au cinéma, a travaillé avec Wim Wenders (
Les ailes du désir et
Until The End of The World), et a aussi publié des livres (
And the Ass Saw the Angel,
King Ink I et
II).
Je ne sais plus exactement comment je l'ai découvert... Probablement dans la bande originale du film de Wim Wenders,
Until the End of the World, vers 1991, ou bien dans ma frénésie de découverte de l'Australie, pays qui m'a longtemps fait rêver, et duquel je voulais tout connaître...
C'est le Nick Cave calme que j'ai le plus aimé en premier, touchée par sa voix hyper grave et mélancolique, il m'a fait le même effet que Leonard Cohen (dont il est un grand fan) que j'écoutais aussi sur vinyl à l'époque. Bref, il n'en fallait pas plus pour que je m'intéresse à lui de près. Avec son groupe de mauvaises graines, les Bad Seeds, il a produit presque 15 albums, sans compter les autres groupes (The Boys Next Door, The Birthday Party, Grinderman...). Il y en a donc beaucoup à écouter de Nick Cave, tout comme il y a beaucoup à dire sur lui.
Mais revenons au concert d'hier soir. Nick Cave faisait partie de cette catégorie d'artistes mythiques que j'aimerais voir au moins
une fois dans ma vie en concert. Et bien j'ai eu cette chance grâce à Pop Montréal qui a réalisé un grand coup cette année !
Ce que j'ai adoré du concert, c'est qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts : autant pour ceux qui aiment le côté plus calme de Cave que pour ceux qui l'aiment déchaîné, des chansons du dernier album,
Dig Lazarus Dig !!! (2008), en passant par Get Ready for Love (
Abbatoir Blues, 2004), The Mercy Seat et Deanna (
Tender Prey, 1988), The Weeping Song (
The Good Son, 1990), Red Right Hand (
Let Love In, 1994), Stagger Lee (
Murder Ballads, 1996)... plus toutes celles que je n'ai pas reconnues.
Le groupe a été bien généreux dans sa prestation et même le grand Nick Cave, surplombant le public des premiers rangs (duquel nous n'étions malheureusement pas), s'accroupissait souvent pour toucher les mains tendues vers lui.
Son acolyte Warren Ellis, jouant du violon, du bouzouki, de la mandoline et de plein d'autres mini-guitares bizarres a produit tout un numéro psychédélique et déjanté en faisant quelques roulades arrières et chantant allongé sur la scène, et offrant à lui seul un spectacle intégral de danse...
Ce que j'ai adoré aussi, c'est que pour la première fois, j'ai vu le public défier l'organisation du concert et se révolter pour avoir un troisième rappel... Ah ça, que c'était plaisant ! Nous avons eu droit à deux autres chansons, alors que les techniciens avaient déjà débranché les amplis...
Nous sommes donc repartis rassasiés, espérant qu'ils reviennent avant 6 ans...
«Jeudi, j’ai assisté à mon énième spectacle de Nick Cave au Métropolis. Chic, moustachu, très rock et très en forme dans un amphithéâtre plein à craquer. Les nuances orchestrales, les ponctuations douces et fines, tous ces effets de style ont fait en sorte qu’on n’a pas regretté les décharges d’autrefois. Non, Nick Cave ne s’est pas autoparodié, loin de là. Il a appris à vivre le rock avec les années qui s’accumulent. Voilà un des artistes les plus complets de sa génération - rock, cinéma, littérature, toutes des formes maîtrisées, d’excellent niveau. Oui, une fois de plus, on a pu contempler un grand créateur. Merci Monsieur Nick.»Alain Brunet, La Presse, 3 octobre 2008« Non, il n'y a rien de pire qu'un événement raté. Et bien pire qu'un événement raté parce qu'on a choisi de ne pas le vivre, il y a celui qu'on a vécu sans vraiment y être. Le spectacle de Nick Cave d'il y a six ans est de ceux-là. Quand je pense que c'était pour la tournée de No More Shall We Part, un des albums qui me soient le plus cher, je m'en arracherais les cheveux. J'ai mis plusieurs années à aimer Nick Cave. À l'époque, j'aimais seulement ses chansons les plus connues comme « Red Right Hand » ou « The Weeping Song », et déjà un peu « As I Sadly Sat By Her Side », peut-être. En fait, je crois que j'avais découvert cette dernière pendant le spectacle... Mais par la suite, de quel amour l'ai-je aimé! Je ne crois pas qu'aucun artiste musical me soit plus cher que Nick Cave.En le revoyant sur scène, mon amour s'est vu à nouveau confirmé. Je me suis rappelée lorsque je l'ai vu sur scène à quel point sa performance m'avait impressionnée déjà à l'époque. Jamais n'ai-je vu chez qui que ce soit d'autre un tel charisme, une telle intensité et une telle sensualité! Dieu qu'il sent le sexe! Nick Cave a une de ces façons de bouger et sa voix, sa voix... Comme l'écrivait avec justesse ma bien-aimée, sa voix est encore plus belle en spectacle que sur disque. Elle se déploie dans toute sa force... Le spectacle était merveilleux. J'étais complètement sous tension pendant toute sa durée. »Chronique trouvée sur Lucidité Homicide, 04 octobre 2008. 
 Je termine l'année en lisant un livre magnifique : L'immeuble Yacoubian, d'Alaa El-Aswani, auteur Égyptien.
Je termine l'année en lisant un livre magnifique : L'immeuble Yacoubian, d'Alaa El-Aswani, auteur Égyptien.